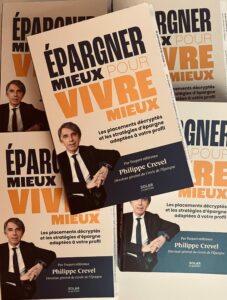Politique de l’offre… vous avez dit politique de l’offre…
Avec ses 3 300 milliards d’euros de dettes et une croissance qui peine à dépasser 1 %, la politique de l’offre, censée être appliquée depuis 2017, aurait échoué. Ses adversaires mettent en avant que le ruissellement promis n’a jamais eu lieu et que, bien au contraire, cette politique n’aurait comme effet que d’enrichir les 0,01 % les plus aisés. Certains préconisent de détricoter les mesures adoptées il y a huit ans et d’autres d’appliquer une politique de relance financée par une augmentation de la fiscalité sur les plus riches.
Question : est-ce que la France a réellement mis en œuvre une politique d’offre ? En 2018, le Président de la République a décidé la poursuite de la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés afin que celui-ci soit proche de la moyenne européenne. Il a institué le prélèvement forfaitaire unique sur les produits financiers en lieu et place de l’application du barème de l’impôt sur le revenu. Il a réduit l’assiette de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune aux seuls biens immobiliers. L’objectif était de faciliter la mobilisation des capitaux en faveur de l’économie dite réelle. Depuis 2017, plus de deux millions d’emplois ont été créés et l’industrie a cessé d’en détruire. Elle a même réussi à en générer plus de 100 000. Le pouvoir d’achat, contrairement à certaines allégations, a augmenté d’environ 12 % sur cette période. Certes, le taux de croissance annuel moyen entre 2027 et 2025 ne dépasse pas 1,3 % : insuffisant pour permettre la réduction du déficit public et la maîtrise de la dette publique. L’accroissement de cette dernière — +1 000 milliards d’euros en sept ans — n’est pas imputable aux seules baisses d’impôts décidées au cours des deux mandats d’Emmanuel Macron. Ces dernières sont à l’origine d’un quart du surcroît de la dette. La majeure partie de celle-ci provient du vieillissement démographique — 50 % — le solde étant la conséquence de la politique du « quoi qu’il en coûte » appliquée durant le Covid.
Mais pouvons-nous parler de politique de l’offre dans un pays où les dépenses publiques ont continué d’augmenter et représentent 57 % du PIB ? La France est dopée de longue date à la politique de la demande. Depuis 1973, le budget de l’État y a été constamment déficitaire. Les dépenses sociales jouent un rôle important sur la demande, s’élevant à plus de 31 % du PIB. Malgré une orientation de la politique économique supposée favorable aux entreprises, les impôts de production en France sont supérieurs à la moyenne européenne : 3,2 % du PIB en 2024 contre 1,5 % en zone euro. Par ailleurs, avec un taux de prélèvement obligatoire de plus de 43 % du PIB, la France figure parmi les pays dont la création de richesses est la plus socialisée au monde. Enfin, le poids de l’emploi public continue de s’accroître. Le nombre de fonctionnaires à temps plein est passé de 5,3 à plus de 5,6 millions de 2017 à 2024, preuve que l’austérité budgétaire est une illusion d’optique.
La prédominance de la demande sur l’offre s’illustre également par la permanence du déficit commercial depuis une vingtaine d’années. Celui-ci a dépassé 80 milliards d’euros en 2024. Aujourd’hui, toute hausse de la consommation se matérialise par une hausse de ce déficit. Avant l’arrivée de l’euro, un tel déficit se serait traduit immanquablement par une crise des réserves de change, la France n’arrivant plus à trouver les devises suffisantes pour s’acquitter des importations. Dans les années 1980, la France avait ainsi dû s’endetter auprès des pays du Golfe pour disposer de dollars en quantité suffisante. Le recours à la dévaluation était un des moyens de rétablissement des comptes extérieurs, le plus souvent assortie d’un plan de rigueur pour éviter l’inflation et réduire la propension à la consommation des ménages. La dévaluation actait un appauvrissement du pays contrairement aux fantasmes qu’elle suscite encore aujourd’hui. En 2025, la France vit au-dessus de ses moyens en raison de l’anémie de son système productif. Il y a trop de demande ou plutôt pas assez d’offre. En effet, nul ne conteste que le pouvoir d’achat des ménages en France a décroché par rapport à celui des Allemands ou des Américains, mais ce décrochage est la conséquence d’une attrition économique. La France se caractérise par un taux d’emploi faible, inférieur de 8 points à celui de l’Allemagne en 2024. Deux à trois millions d’emplois manquent à l’appel. Ces emplois seraient source de création de richesses et de recettes publiques. Ils permettraient de diminuer le volume des prestations sociales.
Face aux défis du vieillissement démographique, de la transition écologique et du réarmement en Europe, la dynamisation de l’économie est une ardente obligation, faute de quoi le pays risque de vivre de désillusion en désillusion. Pour demain retrouver une trajectoire plus favorable en matière de pouvoir d’achat, une réorientation de la politique en faveur de l’offre est indispensable.
Partagez